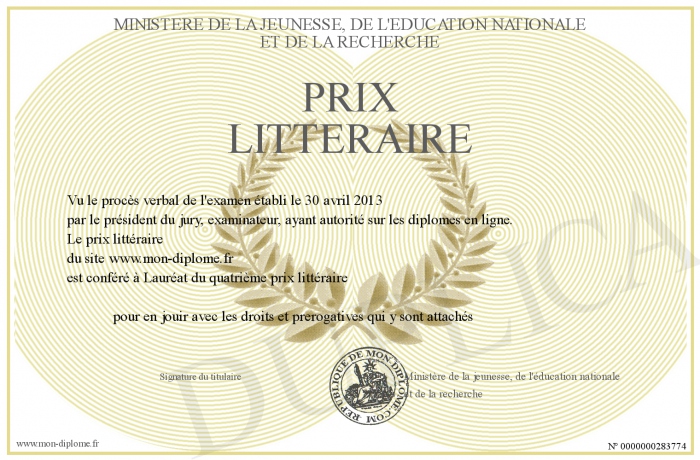« Aborder la littérature par son côté le plus modeste… la critique »
Pierre de BOISDEFFRE
Début septembre, dans la paisible tiédeur d’un petit village cévenol niché au creux des montagnes jadis tant célébrées par le romancier André Chamson, un homme, Philippe Sénart, s’en est allé. Certains ont pu écrire au détour d’un article que « cet homme était l’un des Français les plus cultivés qui se pouvaient rencontrer dans une après-guerre terriblement marquée par les idéologies totalitaires ». Philippe Sénart était avant tout un critique littéraire, amoureux des belles lettres et pétri de littérature classique.
S’il exerçait la profession de magistrat, sa véritable passion était la littérature qu’il apprit à aimer très tôt, à Marseille, au Lycée Saint-Charles. Il eut notamment comme professeur Georges Pompidou, jeune normalien tout frais émoulu de la rue d’Ulm. Même de nombreuses années après, il ne pouvait évoquer certaines anecdotes sans esquisser un petit sourire. Voici la plus célèbre, qu’Eric Roussel, dans son livre sur Pompidou, a, selon les dires du principal intéressé, déformée en lui ôtant tout son sel : « Un jour inopinément, je suis puni de six heures de retenue. « Mais Monsieur, qu’ai-je fait ? », « Ne protestez pas, vous viendrez me voir après la classe ». Après la classe donc : « Mais, Monsieur, qu’ai-je fait ? », « Je n’ai pas à vous rendre des comptes. Vous êtes royaliste, n’est-ce pas. Vous me comprendrez, tel est mon bon plaisir. » Le lendemain il me rappelle : « Sénart, je vous fais grâce ; la grâce est un droit régalien ». Cette rencontre avec Pompidou fut aussi une rencontre avec la littérature, le facétieux maître s’amusant, malgré les protestations des parents d’élèves, à lire à ses jeunes élèves de troisième des contes un peu libertins.
Quelques années plus tard, en 1949, Philippe Sénart fut nommé à Paris, pour prendre ses fonctions à la Chancellerie. Sans jamais négliger son travail de magistrat, il consacrait la majeure partie de son temps à la littérature, rédigeant des chroniques pour la revue de Jean le Marchand, Arts. Même s’il fréquentait peu la rédaction d’Arts, il y rencontrait régulièrement quelques noms dont les annales de la littérature ont gardé la trace : « J’y avais rencontré Maurice Martin du Gard qui me complimenta sur un portrait d’Alfred Fabre-Luce. J’y entrevis Roger Nimier qui nous raccompagna un soir à Saint-Germain-des-Prés avec Le Marchand dans une voiture zigzagante. »
En 1960, Henry Chapier, qui venait d’entrer à Combat, le quotidien de Camus, lui offrit le feuilleton hebdomadaire des pages littéraires. Sa collaboration avec le journal ne cessa qu’en 1974, lorsque le journal disparut. C’est à la même époque qu’il entama une collaboration avec le Mercure de France : « Je rencontrais un jour, dans l’escalier de la vieille maison de la rue de Condé, Georges Duhamel. « Je suis un vieux de la vieille », me dit-il en s’accrochant péniblement à la rampe de l’escalier. » Georges Duhamel, illustre directeur du Mercure de France, devait en effet mourir peu de temps après. A la même époque, Philippe Sénart entrait à La Table Ronde. Il y fit la connaissance, notamment de Gabriel Matzneff, « jeune homme bronzé par le soleil d’Afrique ». Cette rencontre fut le début d’une véritable amitié. S’ensuivirent, dans les années qui vinrent, diverses collaborations, notamment avec La Revue des Deux Mondes, où il tint pendant quelque temps la chronique théâtrale et avec le Figaro.
Je garde surtout le souvenir d’un homme qui, sous ses airs parfois sévères, m’a transmis le goût des livres. Je le revois assis dans le salon de son élégant appartement du 6e arrondissement, enfoncé dans le canapé. Les murs, tapissés de livres poussiéreux, me fascinaient et j’avais l’impression, lorsque je venais le saluer, de pénétrer dans quelque temple de la littérature. J’aurais aimé posséder tous ces livres d’un seul regard, mais c’était impossible et je l’écoutais attentivement me raconter des anecdotes sur les écrivains qu’il avait côtoyés et qui étaient devenus au fil des ans, de véritables amis en littérature. Je partais ainsi à la rencontre d’Eugène Ionesco ou de Julien Green et ces écrivains, morts depuis longtemps, reprenaient vie. Il me parlait aussi parfois du groupe des « Mousquetaires » qu’il formait avec les écrivains François d’Orcival, Gabriel Matzneff et Christian Dedet et dont il était le capitaine de Tréville.
Tous ces souvenirs ont disparu avec Philippe Sénart. Il ne me reste plus que l’amour des lettres, qu’il a su me transmettre au fil de nos rencontres. Ce n’est pas grand-chose.